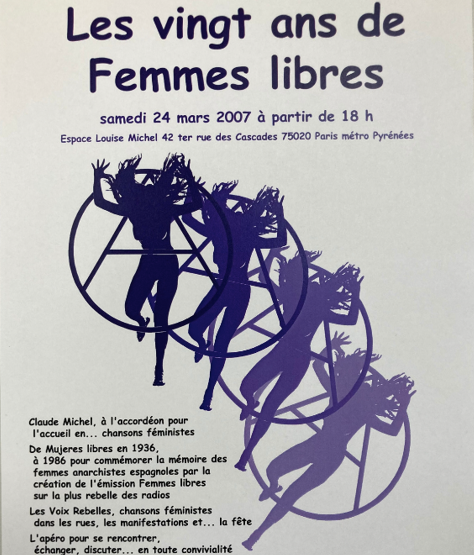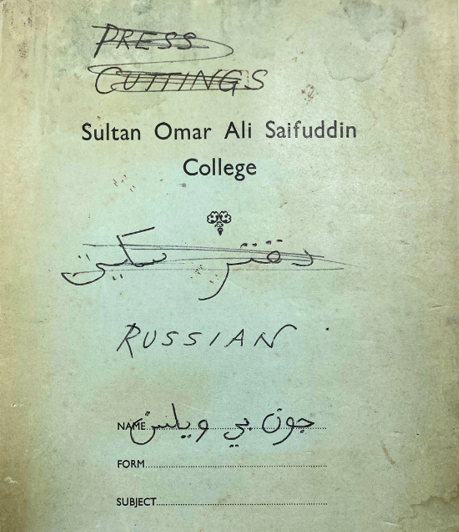La BUA recèle des collections originales mais méconnues : le Centre des Archives du Féminisme (CAF), des archives littéraires et des livres anciens, que le blog “La BU d’Angers sans réserve” vous propose d’explorer.
Ce blog mettra en lumière, au fil de l’actualité, les fonds précieux de la bibliothèque et les animations qui les font vivre : expositions, participation à des journées d’études et à des colloques, visites-présentations du CAF, du fonds ancien et des fonds littéraires…
Que vous soyez étudiant.e, chercheur.se, simple curieux.se, n’hésitez pas à contribuer à la vie de ce blog en laissant vos commentaires.