En décembre 2001, après avoir pendant plus de dix ans respecté jusqu’à l’absurde les dogmes de rigueur prônés par les institutions économiques internationales, l’Argentine connaît la plus grave crise économique de son histoire. Son redressement passera par le retour à des pratiques keynésiennes classiques et par l’affirmation de son indépendance vis-à-vis du FMI. Une leçon à méditer.
En juin 2001 une note de l’OCDE affirmait, pleine d’optimisme, que l’économie argentine était en train de «renaître de ses cendres» et qu’elle renouerait bientôt avec «sa destinée prometteuse du début du siècle». C’était bien le moins. Depuis le début des années 90, la politique économique de ce pays avait scrupuleusement respecté les principes libéraux prônés par cette même OCDE.

Lorsque Carlos Menem arrive au pouvoir en 1989, l’Argentine est déjà en crise. La dictature militaire (1976-1983) et la guerre des Malouines ont ruiné l’économie, la charge de la dette est devenue insupportable et l’inflation rappelle celle de l’Allemagne des années 20 (en 1989 les prix sont multipliés par 50). Pour en sortir, et notamment pour combattre l’inflation, le nouveau gouvernement décide d’indexer le peso au dollar au taux de 1 pour 1 et l’inscrit dans la Constitution (!). Cette mesure, qui avait l’avantage d’éliminer d’un coup l’hyper-inflation coûtait cependant fort cher car il fallait que chaque peso trouve sa contrepartie en dollar dans les réserves de la banque centrale. Il était donc essentiel d’obtenir des dollars des organismes internationaux et des investisseurs étrangers et de se plier aux normes libérales du «consensus de Washington». Après un premier programme de rigueur, l’Argentine approfondit la libéralisation de son commerce extérieur et de ses marchés financiers et se lance dans un vaste programme de privatisation. Jamais État ne vendit autant et si vite : entre 1990 et 1996, téléphone, radios, télévisions, chemins de fer, électricité, eau, gaz, frappe de la monnaie, centrales nucléaires, pétrochimie, poste, aéroports et pétrole sont privatisés, souvent bradés, presque toujours au profit d’entreprises européennes ou américaines détentrices de devises.
Tutelle du FMI
Mais le développement économique promis ne viendra pas. Après une période de croissance, les crises asiatique (1997) et russe (1998) conduisent les investisseurs à quitter brutalement l’Argentine. Alors que le Brésil choisit de dévaluer sa monnaie, le gouvernement argentin préfère maintenir coûte que coûte la parité avec le dollar. La manne des privatisations s’étant tarie et la balance commerciale étant structurellement déficitaire, il n’y a que le FMI qui est en mesure d’alimenter l’économie argentine en devises. Il pose néanmoins des conditions strictes à son engagement et, à partir de 1999, la politique économique argentine est proprement mise sous sa tutelle .
En 1999, le premier programme d’austérité du FMI prévoit la hausse des taxes et des impôts, l’assouplissement de la législation du travail, la réduction des salaires et des pensions des fonctionnaires, la privatisation et la mise en concurrence de la sécurité sociale. Ce plan ne fait cependant qu’approfondir la crise. A peine un an plus tard, le FMI est à nouveau appelé pour un nouveau prêt. Les conditions posées se traduisent cette fois par le gel des dépenses publiques pour 5 ans, la dérégulation du système de santé, l’abolition totale du système étatique de sécurité sociale, une nouvelle hausse des taxes et la réforme des retraites. Ce second plan d’austérité n’a cependant pas plus de succès que le premier et l’économie argentine continue de s’enfoncer dans la crise. Au printemps 2001, un ultime programme de rigueur est concocté par le FMI, fixant des normes rigides de baisse des dépenses publiques pour un montant de près de 8 milliards de dollars sur trois ans. Rejeté par la population, il n’entrera jamais en application mais sera remplacé par d’autres mesures de rigueur.
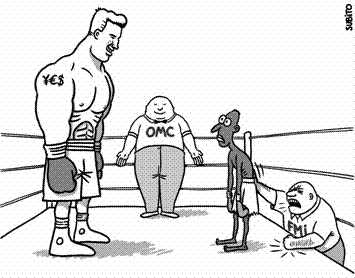
Le bilan de la tutelle du FMI est désastreux. Entre 1998 et 2001, l’Argentine connaîtra quatre années consécutives de récession, son PIB baissant de près de 14 % sur la période. La dette argentine, qui était de 65 milliards de dollars au début des années 90 et de 7 milliards avant la dictature est montée à plus de 155 milliards. Les privatisations ont essentiellement profité aux investisseurs internationaux : 90 % des banques et 40 % de l’industrie argentine sont détenus par des capitaux étrangers. Quant aux indicateurs sociaux, ils sont catastrophiques : le pouvoir d’achat des ménages a diminué de près de moitié en cinq ans, le chômage s’élève à 18 %, la pauvreté, qui atteignait à peine un million de personnes dans les années 70 (pour 34 millions d’habitants) touche à présent 14 millions d’Argentins ; l’analphabétisme est multiplié par six et concerne 12% de la population.
Voilà donc le pays qui, selon les libéraux de l’OCDE, était en train d’accomplir sa «destinée prometteuse» en juin 2001.
Mais le fragile château de carte de l’économie argentine ne tardera pas à s’effondrer. Le 5 décembre 2001, le FMI refuse d’accorder un nouveau prêt au gouvernement social-démocrate argentin. La population, excédée, n’accepte plus les nouvelles mesures d’austérité posées comme conditions par le FMI. Privé de ressources en devises et voulant à tout prix préserver la parité peso – dollar qu’il avait lui-même instauré sous le gouvernement Menem, le très libéral ministre des finances Domingo Cavallo va d’abord chercher à diminuer la masse monétaire en limitant drastiquement les retraits bancaires. Ces mesures sont très mal vécues par la population qui a l’impression qu’on lui vole son épargne alors même que les Argentins les plus fortunés ont eu tout le temps de placer leur argent à l’étranger. C’est le début d’une révolte populaire générale qui va aboutir, en quelques jours, à la démission du président De la Rua.
Que se vayan todos!
Le gouvernement intérimaire ne rompt pas pour autant avec le FMI et continue d’appliquer les recettes libérales. Le peso est dévalué, mais la convertibilité avec le dollar est préservée. Or, les réserves en dollar sont trop faibles pour maintenir une masse monétaire suffisante au fonctionnement de l’activité normale. Pendant quelques mois, l’économie argentine est en partie démonétisée. Les Argentins sont contraints d’inventer des systèmes de troc pour pouvoir travailler et échanger, et les provinces émettent des «patacones», des coupons sans valeur qui permettent de payer les fonctionnaires et les impôts.
Malgré les mesures de rigueur du nouveau gouvernement, les institutions internationales critiquent ces émissions de «fausse monnaie» qui échappent totalement au pouvoir central. En avril 2002 après la démission de son ministre de l’économie, l’Argentine rompt avec les institutions internationales (G7, FMI, Banque mondiale) et aucun nouveau prêt ne lui sera plus accordé.
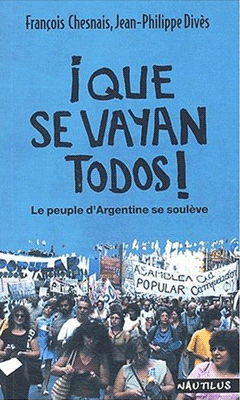
La crise économique et sociale connaît son apogée au milieu de l’année 2002. Entre juin 2001 et juin 2002, le produit intérieur brut a diminué de 13,5 % ; le taux de chômage est monté à 21,5 % et le salaire réel a chuté de 25 % ; le nombre de pauvres s’élève à 19 millions de personnes et concerne plus de la moitié de la population. Malnutrition et faim font leur apparition, notamment chez les enfants ; des scènes de pillage de magasins alimentaires se multiplient. Dans la province de Buenos Aires, la violence juvénile a augmenté de 142 % par rapport à son niveau de 1998.
Tous les jours, les «piqueteros» manifestent devant les sièges des institutions politiques en tapant sur des casseroles. L’ensemble de la classe politique argentine est discrédité. «Que se vayan todos !» (Qu’ils s’en aillent tous !) est le slogan favori des manifestants.
Les élections présidentielles d’avril 2003 instituées pour mettre fin à l’intérim d’Eduardo Duhalde se déroulent dans l’indifférence et l’apathie générale. A l’issue du premier tour, aucun candidat n’est parvenu à rassembler plus de 25 % des voix et le vainqueur se trouve être…Carlos Menem, l’initiateur des politiques libérales des années 90.
Rejeté par l’immense majorité de la population, Menem n’a cependant aucune chance de l’emporter au second tour et se retire le 14 mai, laissant Nestor Kirchner emporter l’élection présidentielle avec son médiocre 22 % du premier tour. Avec ce retrait, Menem fait de Kirchner le président le plus mal élu de toute l’histoire de la république argentine.
Politiques keynésiennes
Malgré ce handicap, le nouveau gouvernement fait preuve d’une véritable autorité et mène une politique économique à l’exact opposé de celle de ses prédécesseurs. Kirchner ne cherche pas les accords avec le FMI mais veut avant tout réaffirmer la puissance de l’État et relancer l’activité par des politiques keynésienne de stimulation de la demande. Ses premières mesures permettent les hausses des salaires, le gel des tarifs publics, la relance de la consommation, la baisse des taux d’intérêt et l’augmentation des dépenses publiques.
En septembre 2003, le FMI propose de nouvelles mesures de rigueur et des privatisations qui sont rejetées par le gouvernement Kirchner. Fondamentalement, l’économie argentine n’a pas besoin de capitaux extérieurs à partir du moment où elle n’indexe pas sa monnaie sur une devise étrangère. L’économie argentine possède en effet beaucoup de matières premières et bénéficie d’un tissu industriel riche et diversifié. En suspendant sa collaboration avec le FMI et en laissant librement flotter sa monnaie, non seulement l’Argentine ne sombre pas dans la crise, mais elle va au contraire connaître un spectaculaire redressement. En 2003, le PIB augmente de 11,3 %, le taux d’inflation recule à 3,7% et le nombre de chômeurs chute de 29 %.
Un bras de fer est engagé avec les détenteurs privés de la dette argentine. Avant la crise de décembre 2001, les taux d’intérêt sur la dette s’élevaient à près de 30 %, alors même que celle-ci était émise en dollar et qu’il n’existait aucun risque de change. De nombreux investisseurs (parfois même des Argentins qui avaient placé leurs avoirs à l’étranger) se sont ainsi considérablement enrichis en spéculant sur la dette argentine. Le gouvernement Kirchner propose depuis plus d’un an de ne rembourser que 25 cents pour chaque dollar prêté. Il a de fortes chances d’y parvenir, ce qui lui permettrait d’effacer 60 milliards de dollars du montant total de sa dette.
Sur le front intérieur, la politique économique est marquée par la reprise en main des services publics. Bien que désormais aux mains du privé, les services publics argentins sont soumis à des règles tarifaires strictes et à une obligation de service. Or ces règles ne sont pas respectées par les multinationales étrangères (dont Suez et EDF) qui réclament des augmentations de tarif pour procéder aux investissements nécessaires au maintien de leur réseau. Pour l’instant le gouvernement argentin reste ferme et menace ces entreprises de retirer leurs licences d’exploitation ou de leur infliger des amendes.
Aujourd’hui, l’économie argentine est en plein redressement, bien qu’elle n’ait toujours pas conclu d’accord définitif avec le FMI et les institutions internationales. Au début de l’année 2004, la production industrielle a dépassé le niveau qu’elle avait en 1997. La balance commerciale est devenue excédentaire (17 milliards de dollars d’excédent en 2003), le taux de chômage a continué de baisser et les chiffres officiels estiment que plus de 800 000 emplois ont été créés en un an au second semestre 2004.
Nestor Kirchner n’est pas un révolutionnaire. C’est avant tout un nationaliste social-démocrate (péroniste) qui a tout simplement préféré appliquer une politique keynésienne standard, fondée sur la régulation économique de l’État, plutôt que de poursuivre jusqu’à l’absurde l’application des dogmes néo-libéraux imposés par les institutions internationales. De son côté le FMI (mais aussi l’OCDE, le G7, la Banque mondiale et les gouvernements des pays industrialisés qui contrôlent ces institutions) n’a cessé de se tromper dans ses analyses et s’est discrédité en alignant les recommandations économiques absurdes. Voici une leçon que les institutions européennes et nos gouvernements feraient bien de méditer à l’heure où les principes libéraux tendent à devenir les références indépassables des politiques économiques.
