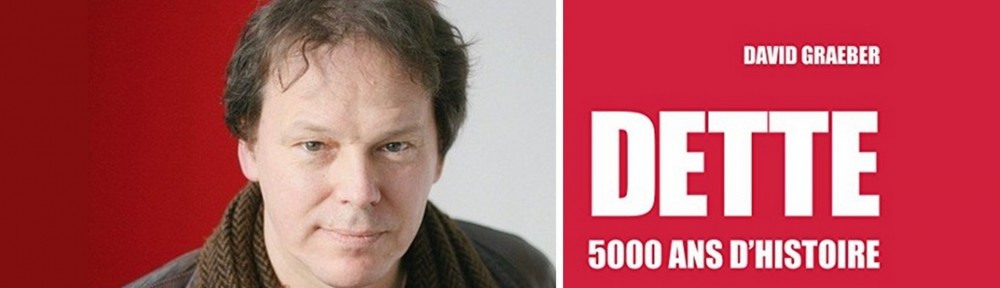Tribune parue dans Le Figarovox.
Peu d’intellectuels peuvent se vanter d’avoir inventé un concept tellement évident qu’il se diffuse en quelques mois dans le monde entier et devient un outil essentiel pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. C’est pourtant ce qu’a fait David Graeber en août 2013 en publiant dans une revue militante un court article consacré aux « bullshit jobs », ces « métiers à la con » qui envahissent les entreprises et le secteur public sans produire la moindre utilité sociale ou économique. Un article qui fut traduit dans de très nombreuses langues dont le français et qui vaudra à son auteur une avalanche de témoignages dont il se servira pour approfondir son concept et écrire un livre entier sur ce sujet.
Il convient ici répondre à un malentendu. Pour Graeber, les métiers à la con ne sont pas les équipiers polyvalents d’une chaine de fast-food, les chauffeurs Uber ou les femmes de chambre des grands hôtel. Ces métiers, tout précaires, mal payés et difficiles qu’ils soient ont une utilité sociale ou économique. Non, les métiers que Graeber étudient se trouvent souvent à l’autre bout du spectre des rémunérations. Ce sont en effet souvent des métiers bien payés et peu précaires, des emplois de bureau engendrés par la bureaucratisation croissante du système capitaliste : les chargés de projet, avocats d’affaire, consultants, lobbyistes, petits chefs sans vrais pouvoir décisionnels ; les « cocheurs de cases » dont l’unique fonction consiste à remplir des tableaux Excel pour établir des rapports d’activité que personne ne lira.
David Graeber ne se contente pas de décrire ces emplois qui rendent souvent fou ceux qui les occupe. Il explique aussi de manière détaillée les causes et les raisons pour lesquelles ils se multiplient. Ainsi, c’est lorsqu’il contredit le discours économique que Graeber est le plus intéressant. Non, le propre de la société capitaliste n’est pas d’être mue par la seule performance et le profit. Derrière les abstractions des manuels d’économie il existe des réalités sociales et anthropologiques, des jeux d’allégeance, des rapports de pouvoir et de domination.
À ce titre, son ouvrage le plus intéressant est sans doute son livre sur la dette que j’ai eu l’honneur de recenser en détail. La dette nous dit Graeber, n’est pas un simple rapport économique. C’est le fondement d’une grande partie des relations humaines. C’est parce que nous nous devons des choses que nous tissons des liens avec les autres. Aussi, contrairement à ce que veut nous faire croire la pensée économique, les dettes sont multiples. Certaines sont fondamentalement non remboursables car elles émanent d’une relation inégale (la dette des enfants vis-à-vis de leurs parents) ; d’autres au contraire se remboursent sans qu’il soit besoin de mesurer l’équivalence (un service que l’on rend à un ami) ; enfin, il existe les dettes monétaires, exigibles jusqu’au dernier centime, des dettes quantitatives qui font abstraction de toute autre considération morale ou sociale. C’est l’obsession de ce troisième type de dette, qui efface toutes les autres, qui caractériserait le capitalisme contemporain estime Graeber.
En somme, pour Graeber, l’erreur fondamentale de la pensée économique est d’avoir été construite sur un mythe : celui qui consiste à croire qu’il existe une réalité économique autonome et indépendante de la société. On retrouve ce mythe dans la manière dont les économistes considèrent les rapports marchands, comme fondés sur le seul intérêt personnel. De même, à les en croire, la monnaie aurait spontanément émergé pour faciliter les opérations d’échange entre individus rationnels et calculateurs, auparavant fondés sur le troc.
Or, rien n’est plus faux explique-t-il. D’une part, la plupart des rapports sociaux ne sont pas le produit d’un calcul économique, et même dans les transactions marchandes, la dimension économique ne peut être totalement dissociée de considérations sociales ou anthropologiques. D’autre part, la société de troc n’a jamais existé et la monnaie n’est pas le produit spontané du marché. En réalité, le monnayage apparaît au VIIème siècle avant JC comme un outil au service de l’État et non de manière autonome. C’est l’introduction des pièces de monnaie standardisées à cette époque qui permet d’organiser un système fiscal performant, de lever de vastes armées et d’instaurer les grands empires de l’antiquité. Les marchés sont le produit de cette innovation, ce qui fait dire à Graeber que, contrairement à ce que croient les économistes de tous bords, les marchés et l’État loin de s’opposer, sont en fait « les deux faces d’une même médaille ».
C’est dans son ouvrage Bureaucratie, que Graeber approfondit sa thèse selon laquelle il existe une imbrication fondamentale entre État et marché. À le lire, le néolibéralisme n’est pas marqué par l’affaiblissement de l’État au profit du marché, mais par l’apparition d’un vaste écosystème où les grandes entreprises et les États agissent de pair pour organiser et renforcer une bureaucratie fondée sur l’obsession du contrôle qui parvient à soumettre des individus à un système de règles souvent aveugles et absurdes. Cette soumission à la règle est d’autant plus néfaste qu’elle isole la bureaucratie de la société réelle et qu’elle engendre toute une armée de « métiers à la cons » qui ne sont là que pour servir la règle au lieu de remplir une vraie fonction sociale. On en revient aux « Bullshit jobs ».
Soyons clair. La vision de l’État que développe David Graeber est celle d’un anarchiste anti-capitaliste qui voit derrière toute institution puissante des rapports de force et de pouvoir illégitimes. Graeber était en effet un militant influent autant qu’un intellectuel, l’une des figures du mouvement Occupy Wall Street de 2011. Mais même quelqu’un qui ne partage pas ses convictions ne peut balayer ses critiques d’un revers de main car celles-ci s’appuient toujours sur une analyse fine et détaillée des rapports sociaux. En bon anthropologue, Graeber maitrisait parfaitement les ressorts cachés de nos comportements et il savait faire passer ses idées foisonnantes à ses lecteurs tout en présentant une pensée structurée et cohérente.
Son décès brutal alors qu’il venait de terminer un dernier ouvrage consacré à la piraterie est une perte immense pour toute personne qui ne renonce pas à comprendre le monde et à en faire une analyse critique.