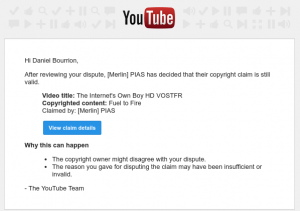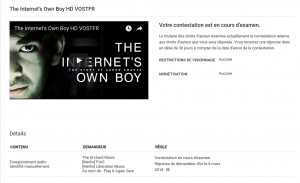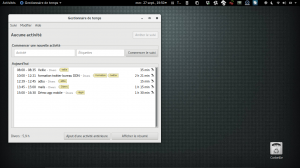Contexte : voici dix ans, la promotion DCB15, dite promotion Flora Tristan, quittait l’Enssib. Afin de marquer cet anniversaire, l’idée de créer un site web regroupant des témoignages des membres de cette promotion se penchant sur leurs parcours professionnels individuels a émergé mais, pour diverses raisons, cette idée n’est restée qu’une idée, et le site à l’état de brouillon.
Voici toutefois le billet que j’ai écrit pour l’occasion. Il synthétise 3650 jours.
 J’ai souvenir des derniers jours et de l’été qui commençait, des rendez-vous avec les recruteurs, de nos mines endimanchées dans les couloirs où restait encore un peu d’ombre, du sentiment que j’avais de la fin de l’année, peu ou prou bien le même que celui qui, depuis mes premières rentrées, termine toujours le mois de juin — une impression de fin qui n’a aucun retour, cette urgence que l’on sent à dire ce qu’il faut dire, et puis aussi évidemment, la peur de ce qui vient derrière le long tunnel éclatant du soleil, la rentrée qui s’annonce et avec elle aussi, les premiers pas de professionnel qu’on sait ne pas être du tout.
J’ai souvenir des derniers jours et de l’été qui commençait, des rendez-vous avec les recruteurs, de nos mines endimanchées dans les couloirs où restait encore un peu d’ombre, du sentiment que j’avais de la fin de l’année, peu ou prou bien le même que celui qui, depuis mes premières rentrées, termine toujours le mois de juin — une impression de fin qui n’a aucun retour, cette urgence que l’on sent à dire ce qu’il faut dire, et puis aussi évidemment, la peur de ce qui vient derrière le long tunnel éclatant du soleil, la rentrée qui s’annonce et avec elle aussi, les premiers pas de professionnel qu’on sait ne pas être du tout.
Et dix-huit mois après le premier jour
Nous sortions de mois qui avaient été, eux aussi, un tunnel. Les images sont nombreuses qu’on accumule en tant de jours, mais il surnage quelques moments, qui seraient des virages. Et le premier, ce sont ces premiers jours de la première semaine où les visages, les figures, ont commencé à se poser sur des noms, des gens, pendant que je me demandais s’il me fallait rester tant je ressentais l’énorme décalage qu’il y avait entre moi, ce que je savais, ce que j’étais, et ce que je pressentais, sentais, des personnes tout autour, à mes yeux stratosphériquement intelligentes et brillantes. Évidemment, je suis resté, il le fallait, ne serait-ce que pour voir où ça irait.
Je me souviens aussi de la première fois où quelqu’un, qui est ici sans doute à lire, m’a parlé de WordPress, lequel WordPress, ironie de l’histoire ou information de fait sur la persistance de l’outil, fait tourner le site sur lequel nous sommes à présent, devisant du temps qui passe et du métier qui reste. Moi qui avait jusque là un petit site caché quelque part sur le Web et dont les pauvres pages, qui faisaient ma grande fierté, étaient faites d’un HTML garanti main, je découvrais soudain la puissance d’un CMS, la facilité qu’il donnait à organiser les contenus, cette liberté que la séparation de la forme et du fond permettait, et qui faisait qu’avec peu de clics, rapidement, un site web pouvait changer du tout au tout, au moins visuellement, ce qui n’est pas rien dans l’expérience qu’on en a comme lecteur.
Je me souviens également de la découverte de XML, des cours plein de malices sur un sujet pourtant aride, de l’émerveillement que j’ai ressenti devant la simplicité de ce langage et de son extensibilité, de ce qu’il laissait deviner de possibles et à évoquer cela, je m’aperçois sans surprise que j’ai tout oublié ou presque de ce que j’ai appris alors, à part quelques noms, TEI, XSL-FO — l’une des choses qui émergent pour moi dans le bilan de ces dix années écoulées, c’est à quel point les savoirs techniques sont volatiles dès lors qu’on ne les utilise plus au quotidien.
Je me souviens, encore, et ce ne sont que deux exemples1, de grands moments de plaisir intellectuel. Je peux citer ainsi un cours sur FRBR magistralement mené par un intervenant dont j’ai oublié le nom, et qui a eu l’heureuse et pédagogique idée de nous faire refaire, from scratch et sous forme de travaux pratiques de groupes, le parcours intellectuel qui avait conduit à l’élaboration du modèle FRBR : pour une fois, foin d’un cours magistral, nous avons réfléchi comme des fous, les migraines ont été nombreuses mais payantes, et j’ai encore en moi la joie de ce jour de sentir mes neurones s’agiter en tout sens telles des puces devenues folles.
Je peux aussi citer l’Enssib parallèle, une série de mini-exposés que nous organisions le soir au sein de la promotion sur un principe simple : n’importe qui d’entre nous avait toute latitude pour intervenir sur un sujet lui tenant à cœur, devant notre auditoire volontaire. Ce petit dispositif, je le sais, a énormément compté à mes yeux, en ce qu’il m’a permis de découvrir la palette impressionnante des intérêts multiples des personnes partageant mon quotidien d’élève-conservateur — j’ai confirmé là, je crois, l’impression diffuse que j’avais de la force du collectif, impression qui n’a fait que se confirmer au long des mois de notre formation puis plus tard, mais j’y reviendrai.
J’ai fait mes premiers pas
J’ai évoqué plus haut la période finale, celle où la promotion s’alignait en face des postes proposés aux sortants d’école par les établissements prêts à accueillir dans leurs rangs des débutants, ou presque2. Pour moi, ce moment crucial n’a été d’aucune tension : le hasard avait bien fait les choses, le poste de mes rêves, que je lorgnais depuis des mois, s’était par miracle libéré, les rendez-vous de contact avaient été réalisé en amont du mouvement de sortie et pour tout dire, la fiche du poste en question, proposée aux sortants de la DCB 15, était profilée pour que je sois quasi le seul à y correspondre. De fait, mes camarades m’ont laissé sans débattre aller où je voulais.
On évoque peu le stress du débutant. Il y a un soir, il y a un matin, et l’on passe d’un seul coup d’élève-conservateur à professionnel des bibliothèques dont tout le monde, et en particulier les équipes qu’il encadre, est en droit d’attendre qu’il le soit, professionnel, alors même que par définition, c’est impossible, puisque manque l’essentiel : une expérience.
Pour ce qui me concerne, la difficulté a été relative, mon ancien métier m’ayant habitué à plus lourd, plus tendu, plus imprévisible surtout, mais tout de même, du jour au lendemain, me voilà à prendre la tête d’une équipe Bibnum et la relève de mon prédécesseur à cette place de responsable de la section Bibliothèque numérique de la Bu d’Angers dont le moins qu’on puisse dire est qu’il (mon prédécesseur) en a sous le capot — il est des situations de challenge qui vous poussent à travailler encore mieux, et plus, et celle-là en a été.
Pour l’essentiel, de ces sept années passées à piloter cette section assez particulière au sens où elle était, dans l’organigramme, l’équivalent des deux autres sections physiques de l’établissement, ce qui symboliquement et politiquement, était un geste fort, les apprentissages ont été principalement techniques avec évidemment, une masse d’outils à appréhender ; et organisationnels, tout particulièrement dans ce qui concerne les interactions avec les autres services de l’Université : je n’imaginais pas jusqu’alors à quel point une Université est un éco-système complexe avec lequel il faut composer, un paquebot qui si agile qu’il se veuille ne change pas de trajectoire aussi rapidement qu’il le faudrait, qu’on le voudrait.
Après ces premiers pas, diverses circonstances sur lesquelles il n’est pas nécessaire de revenir firent que j’en vins à quitter la bibliothèque pour rejoindre la Direction du Développement Numérique de l’Université d’Angers, plus connue partout ailleurs sous l’intitulé de D.S.I., sur un projet de pôle hébergé au Lab’UA et se donnant pour mission d’accompagner les chercheurs sur leurs données et publications. Durant deux années, la difficulté se révéla alors tout à la fois, de maintenir à flot un pôle créé ex-nihilo ; et de le rendre visible et audible auprès des chercheurs, sur des thématiques dont ils peuvent être parfois éloignés. La tâche fut difficile, et le pôle ne dépassa son deuxième anniversaire, le Lab’UA se recentrant sur un support strictement pédagogique. Évidemment, la pilule s’avéra un peu amère, mais de cette période, il reste Okina, l’archive ouverte institutionnelle qui fut montée au sein du pôle Données et Publications de la Recherche que je pilotais alors — pour Okina, je n’ai pas fait grand chose sinon pousser à la roue, mais c’est une fierté, assurément, d’avoir montré avec mon équipe d’alors qu’un tel projet pouvait parfaitement être monté, et très rapidement encore, si l’on se remontait vraiment les manches.
Depuis ? Depuis, je reste à la Direction du Développement Numérique de l’Université d’Angers, en responsable cette fois du tout récent Service de Transformation Numérique, un petit service (par la taille, mais les gerboises vont toujours plus vite que les éléphants) dont la mission est d’accompagner l’Université sur l’intégralité de sa stratégie numérique (vaste programme, lié aussi de fait à mon statut officiel récent de CDO de l’Université).
Voilà, esquissée en quelques lignes, dix années. L’exercice en cours ici est celui d’un bilan, d’un regard rétrospectif sur le chemin fait, les années écoulées. Si dix années constituent un vaste vivier où piocher de quoi réfléchir, à m’y pencher, je vois que des lignes de forces se dessinent dans mon parcours, qui ne sont pas si nombreuses qu’elles ne puissent pas être évoquées toutes ici.
Des bibliothèques pour tout et puis pour tous
Lors du concours de conservateur, au moment du grand oral (appelons-le comme cela histoire de rendre ce rite de passage solennel), l’un des membres du jury m’avait posé une question dont je savais qu’elle arriverait3 : passant ledit concours en interne, mais comme Conseiller Principal d’Éducation, métier qui peut paraître lointain des bibliothèques, je sentais qu’il me faudrait justifier cette bifurcation professionnelle. Cela me manqua pas : Pourquoi voulez-vous donc devenir Conservateur des bibliothèques, vous qui êtes CPE ? Ce sont des métiers très différents, non ?, me demanda-t-il.
La réponse est facile. Les métiers paraissent certes différents, et de beaucoup, et rien ne semble relier le CPE intervenant au milieu d’un conflit, voire d’une bagarre, au Conservateur des Bibliothèques en charge du numérique. Mais il y a des points communs, qu’on peut résumer par cette phrase qui a été, peu ou prou, ma réponse alors : dans une bibliothèque, dans un établissement scolaire, l’enjeu est d’accueillir tout le monde, de faire vivre tout le monde ensemble, l’enjeu est de faire que tout le monde ait progressé vers le meilleur quand le jour se termine, l’enjeu est que chaque personne apprenne quelque chose au cours de son passage, dans la bibliothèque, dans l’établissement scolaire, donc non, ces deux métiers, dans leurs visées, ne sont pas tellement différents quand seuls les éloignent les moyens dont ils disposent, et encore.
Cette réponse est certes un peu grandiloquente, il faut s’imaginer le cadre, le jury, le candidat dans son costume à peine étrenné et qu’il ne portera plus guère, la tension qui règne, quoi qu’on dise. Mais le fond, lui, n’a pas pris une ride et de ces dix années, chacune de mes actions, chacun de mes projets, au final, a tendu vers cela, participer à ce que nous, usagers que nous sommes ou servons, professionnels avec lesquels nous travaillions, progressions ensemble vers un meilleur dont je crois profondément qu’il passe par le savoir et la culture, tous les savoirs, toutes les cultures.
De là, évidemment, on rejoint facilement d’autres thématiques qui me sont chères, celles de l’accès ouvert, libre, et gratuit autant que faire se peut, à des savoirs, des cultures, des outils, en fait, tous ces mouvements dont le nom commence par Open ou se termine, francisé, par Ouvert.e et parmi lesquels évidemment, la thématique de l’Open Access, dont je pense, pour en avoir parlé ailleurs, ce qui m’évitera d’y revenir ici, qu’elle est un combat fondamental pour les Bibliothèques universitaires, combat qui, en dix années, n’a pas à mes yeux avancé assez4.
Mais pour ne pas quitter le sillon premier, ce que j’ai appris en ces années, c’est que la bibliothèque, assurément, était l’un des hauts lieux où il m’était possible d’œuvrer aussi, comme auparavant dans la cour du lycée, à un bien-vivre ensemble, à un bien-vivre mieux, intelligent ; et aussi, que la bibliothèque, comme hub, lieu de croisements, de partages, était certainement l’un des lieux les plus adéquats pour y faire preuve d’humanité, fut-elle numérique (ce qu’elle est et sera, sans aucun doute).
Éloge de la bibliothèque (numérique)
Ces ans entassés, je les ai passés quasi exclusivement à travailler des projets numériques, par choix, par goût, par envie, et aussi, clairement, parce que j’ai l’absolue certitude que la bibliothèque, c’est la bibliothèque numérique ou plutôt, qu’une bibliothèque ne peut qu’être numérique, ou encore, qu’il n’y a nulle rupture entre le monde des bibliothèques « physiques » et celui, éthéré, dans le cloud, qui serait celui où j’évolue quotidiennement, comme jadis à la BU d’Angers, comme ensuite au Lab’UA, comme maintenant à un niveau plus global où finalement se croisent exactement, toujours, les mêmes enjeux, que je viens d’évoquer, le tout, pour tous.
Lorsque je me suis installé dans mon premier poste, je répétais souvent que de disposer d’une section numérique, affichée comme telle dans la structure d’ensemble de la bibliothèque, était réel signe politique quand souvent, le numérique n’est qu’une vague mission transversale, voire un thème externalisé. C’était aussi pour moi un espoir, celui de voir considérées les tâches numériques non pas comme une spécialité hors les bibliothèques5, mais bien, comme une part entière du métier des bibliothèques, au même titre que la gestion physique des collections ou l’accueil des flux d’usagers, dans le continuum qui est le nôtre et se déplie du papier toilette au cloud.
La place du numérique dans la bibliothèque me semble toujours pourtant aujourd’hui faire débat, et mes constats vont tous encore dans le même sens d’une sorte de dichotomie, de coupure, entre la bibliothèque des bibliothécaires « classiques », et son versant numérique censément réservé à une sorte particulière des bibliothécaires un peu geeks relégués dans leur particularisme. Les jours où le pessimisme gagne, j’ai même tendance à penser que la bataille est perdue parce que globalement, je constate un affaiblissement de la fonction numérique et informatique repérée comme telle dans les bibliothèques, qui devrait être confiée à des bibliothécaires spécialisés6 mais qui, donc, disparaît lentement des radars.
Je ne sais qu’en dire de nouveau. Je ne peux que répéter ce que je ne cesse de dire, que l’explosion faramineuse des outils numériques, des pratiques numériques7, que l’outil fantastique que sont le Web, les terminaux mobiles que nous avons toutes et tous, comme nos usagers, dans nos poches et nos cartables, nos sacs à dos, sont autant d’occasions historiques, pour nous, bibliothèques, de remplir nos missions. Je ne peux que répéter que, à un moment où un flot d’informations absolument inédit dans l’histoire de l’humanité déboule de toutes parts, nous n’avons jamais été aussi nécessaires pour aider à organiser, valoriser, structurer, comprendre, critiquer, assimiler, et que cela passe par la prise en main directe et franche de ce monde numérique, parce que la bibliothèque, en 2018, c’est la bibliothèque numérique (et inversement). Je ne peux que répéter, enfin, de manière plus imagée, que nous avons le cul sur un tas d’or, mais que nous dormons en rêvant du passé.
Vers le présent
Le pourquoi de cette situation, j’en vois quelques explications, assez claires, déjà sensibles il y a dix ans, et toujours évidentes maintenant, tenant principalement au recrutement des personnels de bibliothèques et en particulier des conservateurs. On le sait, le concours, sas d’entrée et filtre, ne porte aucunement sur la capacité à faire, mais sur celle à dire — il ne s’agit pas de montrer qu’on sait faire, mais de dire qu’on saura faire, dans une sorte de logique performative : je sais réfléchir, je sais le dire, je saurai le faire, et du numérique, comme du reste, je ne ferai qu’une bouchée, puisque je sais penser.
Il y a loin toutefois du discours au concret du monde, et pour ce qui concerne la partie qui est la mienne, il y a loin du discours sur le numérique à sa compréhension « intime », comme il y a loin entre les ouvrages savants décrivant par le menu comment l’on fait de la bicyclette, et les chutes, les crampes, le mal au fondement, qu’est l’expérience d’une promenade à vélo.
Ce phénomène, par ailleurs, est amplifié par les logiques de miroir, d’entre-soi, propre à tout concours organisé par des structures encore très classiques, regroupant des jurys dont souvent, les membres sont loin d’avoir une expérience concrète du numérique, de celle qu’on acquiert les mains dans le cambouis. In fine, tout est ainsi en place pour une sorte de reproduction des schémas et des modes de fonctionnement, tout est en place pour que les recruteurs, trop souvent loin du numérique, recrutent leurs mêmes, bouclant la boucle d’un monde qui ne saute pas le pas pour aller dans ce qui est simplement notre présent, au moins, celui de tous nos usagers.
Peut-être qu’il serait enfin temps ici de réfléchir aux missions des bibliothèques, au levier que représentent les outils numériques pour atteindre à ces missions, peut-être qu’il serait temps de considérer que ces outils ne peuvent plus être ignorés, connus, explorés, maîtrisés, par ceux, celles qui sont amenés à piloter les bibliothèques, peut-être qu’il serait temps de se rendre compte, collectivement, qu’un espace nouveau est là, qui ne relève pas d’un phénomène de mode qu’il suffit de laisser passer, dans lequel nous devons être, si nous ne voulons pas qu’il se fasse sans nous. Et peut-être, sans doute, qu’il serait temps de modifier radicalement les règles du jeu qui fonde le recrutement de ces pilotes censément éclairés en faisant de la pratique numérique un incontournable des épreuves du concours.
Par ailleurs, je pense aussi qu’il est plus que temps d’horizontaliser nos fonctionnements, que le moment est venu de démonter les chaînes hiérarchiques, parce que nous perdons beaucoup à ne pas écouter, entendre, considérer ce qui nous vient d’idées, d’envies, d’aptitudes, de compétences numériques, de la part de nos collègues8 (et je pourrais ajouter, de nos usagers). Ici, mon propos est bien de dire que nos organigrammes doivent être démontés et que peut-être, cela commence, dans le monde physique, par des choses simples, des lieux professionnels où le cadre, le conservateur, ne travaille plus seul dans son bureau tour d’ivoire mais est assis auprès de son équipe, dans des bureaux communs.
Du collectif-web
De tout ce temps, on tire des leçons, sauf à avancer sans jamais se retourner, et encore. Les lignes qui précédent esquissent les contours de certaines de ces leçons, et peut-être que l’on sentira, en filigrane, une certaine désillusion : le débutant qui quittait l’Enssib en juin 2007, et le quinquagénaire légèrement plus aguerri maintenant, auraient beaucoup à se dire, et s’engueuleraient très probablement s’ils devaient se rencontrer à la faveur de quelque pli de l’espace-temps, le premier pensant que tout est possible rapidement, le second le tempérant certainement avec cette sorte de lassitude qui vient à force de pousser sa pierre dans un environnement, des fonctionnements, qui ne changent pas, ou en tous cas, pas aussi vite que le monde autour.
Il y a cependant un point qu’il faut relever, pour terminer, et qui redonne espoir. J’ai dit plus haut comment, lors des séances de l’Enssib parallèle, j’avais senti poindre la force du collectif, ce qui pouvait se passer quand des individus, si hétérogènes qu’ils soient, partageaient leurs connaissances et leurs différences. Dans le même temps, et je l’ai découvert là-bas, naissaient de petites choses comme Twitter ou Facebook, et grossissait une biblio-blogosphère9, tous évènements alors anodins mais qui, à mes yeux et avec le recul, ont participé à la mise en place, dans mon domaine professionnel, d’un collectif dont je vois s’exprimer chaque jour la force dans les échanges à distance qu’il permet, dans l’entraide qu’il autorise, dans le rire qu’il apporte. Mes collègues sont ainsi autant mes voisins de bureaux que ceux, celles dont parfois je n’ai jamais vu le visage, mais avec qui je suis, travaille, chaque jour, au travers de l’écran.
Ce changement-là, cette extension vers l’immatériel d’une force de travail, cette naissance d’un collectif, cela, pour moi, est assurément le point positif qui surnage des dix ans et dont, je crois, peu de personnes prennent encore conscience dans mon entourage professionnel comme dans les structures de pilotage des bibliothèques, clairement, par absence de pratique. Ici, en dix années, j’ai le sentiment très fort que mon espace professionnel, et les puissances de travail comme de réflexions que je peux y mobiliser, s’est ouvert au-delà de tout ce que je pouvais imaginer en quittant l’Enssib, me donnant la possibilité, à tout moment, de réellement échanger avec un groupe de professionnels dans un espace immatériel surplombant mon quotidien et, pour tout dire, le dépassant, comme une couche qui viendrait en plus et donnerait à tout énormément plus de force et de goût.
Au-delà de la reconnaissance toujours insuffisante du numérique comme pivot essentiel des bibliothèques, au-delà de que nous pourrions faire pour l’Ouvert et que nous ne faisons pas, au-delà des lourdeurs terribles qui nous plombent, faisant disparaître dans le sable nos énergies et nos projets, cette naissance d’un collectif-web, que je retrouve par ailleurs dans d’autres de mes activités lorsque je sors de la bibliothèque ou du bureau ; cette naissance d’un collectif-web qui est aussi un « corps-web », assurément, est le principal point positif qui surnage sur les dix années passées. Pour le reste, qui doit être encore amélioré ou même tout simplement entamé, réalisé, on y travaille.
1. Il y en a d’autres évidemment, dont les soirées de la Coquette de Lyon, atelier d’écriture où, assurément, nous avons bien ri.↩
2. Certains, certaines d’entre nous ne l’étaient pas, arrivé.e.s d’emblée plein d’une expérience dont les débutants, les vrais, dont j’étais, avaient pu profiter.↩
3. C’est l’un de mes conseils de préparation du concours, d’ailleurs : chercher les questions qu’inévitablement, votre parcours antérieur fera apparaître, pour mieux préparer votre réponse. L’autre conseil, c’est de passer des oraux blancs pour que d’autres repèrent les points questionnants de votre parcours, points qui attireront forcément l’attention du jury.↩
4. Nous aurions pu aller plus vite, gagner des batailles plus décisives, mais je ne sais pourquoi, il règne ici une pesanteur, une inertie, qui gâchent tout.↩
5. Ce qu’elles sont dès lors que les missions numériques relevant de la bibliothèque sont externalisées, éloignées, renvoyées aux services spécialisés de type D.S.I. où, quoi qu’on fasse, elles (ces missions) se diluent parmi d’autres tâches.↩
6. Cette spécialisation, nécessaire à mes yeux parce que le numérique ou l’informatique documentaires ont des spécificités techniques et culturelles dont les collègues informaticiens sont loin, chacun son métier, n’étant en rien incompatible avec, d’une part, la nécessaire acculturation de tous les personnels de bibliothèques à ces outils et problématiques ; d’autre part, un travail conjoint avec les D.S.I. support, les spécialistes « internes » que j’évoque jouant le rôle, littéralement, d’interfaces entre ces différents acteurs.↩
7. Et je ne parle même pas des Humanités numériques sur lesquelles pourtant nous devrions nous jeter, nous, conservateurs issus pour notre très grande majorité de filières strictement littéraires.↩
8. C’est souvent que l’on m’a raconté, ici ou là, comment tel ou telle, venant avec son idée de service, sa proposition numérique, avait été envoyé.e. dans les cordes dans un mépris hiérarchique cachant aussi, de manière visible, une incompréhension technique ou sociétale.↩
9. Biblio-blogosphère qui depuis a quelque peu été asséchée au profit des échanges sur les réseaux sociaux, mais c’est une autre problématique.↩
NB : le cliché illustrant cet article a été placé sous licence CC0 par David Verbrugge.

 J’ai souvenir des derniers jours et de l’été qui commençait, des rendez-vous avec les recruteurs, de nos mines endimanchées dans les couloirs où restait encore un peu d’ombre, du sentiment que j’avais de la fin de l’année, peu ou prou bien le même que celui qui, depuis mes premières rentrées, termine toujours le mois de juin — une impression de fin qui n’a aucun retour, cette urgence que l’on sent à dire ce qu’il faut dire, et puis aussi évidemment, la peur de ce qui vient derrière le long tunnel éclatant du soleil, la rentrée qui s’annonce et avec elle aussi, les premiers pas de professionnel qu’on sait ne pas être du tout.
J’ai souvenir des derniers jours et de l’été qui commençait, des rendez-vous avec les recruteurs, de nos mines endimanchées dans les couloirs où restait encore un peu d’ombre, du sentiment que j’avais de la fin de l’année, peu ou prou bien le même que celui qui, depuis mes premières rentrées, termine toujours le mois de juin — une impression de fin qui n’a aucun retour, cette urgence que l’on sent à dire ce qu’il faut dire, et puis aussi évidemment, la peur de ce qui vient derrière le long tunnel éclatant du soleil, la rentrée qui s’annonce et avec elle aussi, les premiers pas de professionnel qu’on sait ne pas être du tout.